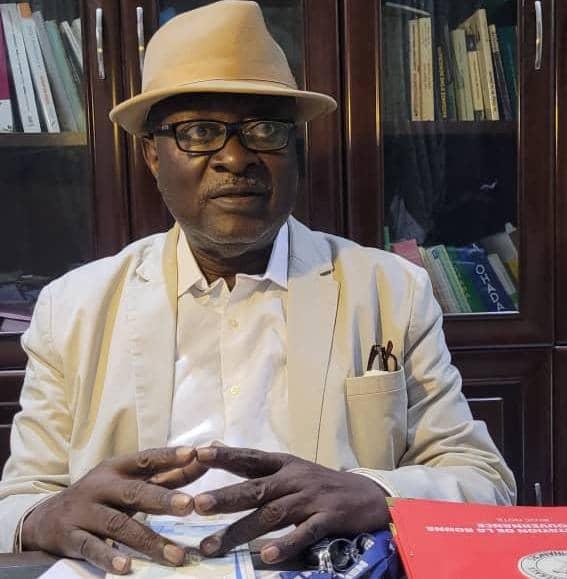
L’accord de paix signé le 27 juin 2025 à Washington entre la RDC et le Rwanda soulève à l’intérieur du pays des sentiments controversés au niveau tant de la classe politique que de la population elle-même. Les deux catégories se posant légitimement la question de savoir si la fin de la guerre est à l’horizon ou s’il s’agit d’un nouveau camouflet qui serait cette fois la base de la balkanisation ou de l’éclatement pur et simple de notre pays.
En effet, eu égard aux massacres et aux différents désastres perpétrés à l’Est de la République Démocratique du Congo à la suite de l’agression rwandaise, un bon nombre de congolais dans leurs diversités sont sceptiques de croire à la bonne foi du Rwanda d’une part et d’autre part au retour effectif de la paix du fait de l’accord intervenu à Washington le 27 juin 2025.
Il nous revient de rappeler que suivant la convention de Genève 1969 en son article 2, un accord est « un engagement écrit entre sujets de droit international, principalement les États et parfois les organisations internationales, par lequel ils s’engagent volontairement à respecter certaines obligations juridiques ».
C’est le cas en ce qui concerne l’accord sous examen entre la RD Congo et le Rwanda. Aussi du point de vue doctrinal, Si un accord de paix interne est signé sous l’égide de la communauté internationale, il peut être doté d’une valeur quasi-internationale, même s’il s’agit d’un accord (convention, protocole etc …) entre un Etat et un groupe armé.
Par ailleurs, nous devrions noter également qu’au niveau international, un accord n’est jamais parfait, parce que d’un côté il est rare qu’il puisse résoudre tous les aspects du problème qui divisent les parties et d’autre part, il peut faire jaillir des faiblesses assez significatives par rapport à son application sur terrain.
En ce qui concerne la situation de quelques accords portant sur la paix en Afrique, nous pouvons nous référer à titre illustratif aux six cas précis dont l’application a été soit appréciable soit non satisfaisante.
Les trois premiers exemples peuvent être considérés parmi les modèles d’accord à effets positifs dans le domaine de la paix et de la sécurité en Afrique. L’accord de Dakar signé entre le Tchad et le Soudan en 2008, et dont l’objet était de mettre fin au soutien mutuel à des groupes rebelles, avait abouti à un cessez le feu et une reprise des relations diplomatiques, ainsi qu’à une réduction notable des incidents frontaliers. Le conflit indirect avait été donc désamorcé et la coopération sécuritaire avait été restaurée.
L’ accord de Maputo de 1992 entre le gouvernement du Mozambique et le RENAMO, groupe rebelle soutenu à l’origine par la Rhodésie (Zimbabwe) et l’Afrique du Sud avait abouti à la fin de la guerre civile au Mozambique. L’ accord de Juba entre l’Ouganda et le Soudan de 2006 avait pour objectif de mettre un terme au soutien présumé du Soudan au groupe rebelle ougandais LRA. Il a permis la cessation du soutien du Soudan aux LRA et une diminution drastique des activités des rebelles LRA ayant perdu leur base arrière au Soudan.
Ces trois différents accords signés par les belligérants sous l’égide de la communauté internationale avait mis fin, comme nous venons de le souligner à ces différentes crises. Et leurs effets positifs sont demeurés incontestables jusqu’à ce jour.Par contre les trois accords ci-dessous font partie de ceux qui n’ont pas abouti à des résultats satisfaisants.
L’accord de paix d’Alger entre l’Erythrée et l’Ethiopie de 2000 qui devait mettre fin à des guerres des frontières entre 1998 et 2000, prévoyait une démarcation claire de la frontière. Mais l’Éthiopie avait refusé d’appliquer certaines décisions de la commission de délimitation, notamment sur la ville de Badmé, ce qui avait gelé la paix pendant près de deux décennies. Ce n’est qu’en 2018 que les deux États ont officiellement normalisé leurs relations (Accord d’Asmara).
L'accord de 2000 a été donc inefficace pendant près de 18 ans.
Quant à l’accord de Syrte de 2007 entre la RCA et le Soudan, il était censé résoudre le conflit frontalier et mettre fin au soutien présumé du Soudan aux groupes rebelles centrafricains. Mais la signature de cet accord avec la médiation libyenne n’avait pas empêché les affrontements et les flux d’armes dans la région. Les violations multiples ont conduit à une dégradation du processus de paix.
Et enfin, l’accord d’Arusha de 1993 entre le gouvernement hutu rwandais et le Front Patriotique Rwandais (FPR) dont le but était d’intégrer les forces du FPR dans l’armée et au gouvernement n’avait pas été appliqué suite au crash qui a couté la vie au Président rwandais Juvénal Habyarimana et son homologue burundais Cyprien NTARYAMIRA. Dès lors le processus de paix au Rwanda avait volé en éclat.
Ces différents exemples nous indiquent qu’ ayant évolué dans un sens ou dans l’autre font clairement ressortir la délicatesse des accords qui sont négociés et signés au niveau international. Le mérite est de le savoir en vue de prendre des précautions nécessaires pour protéger les intérêts de son propre pays.
A présent, qu’en est-il en ce qui concerne la réussite de l’accord entre la RD Congo et le Rwanda. Faut-il être pessimiste et verser vers le découragement ou devons-nous considérer que la paix est effectivement à la portée du Peuple congolais et de ses dirigeants.
Suivant le contenu de l’accord signé par les deux parties, nous pouvons relever de part et d’autre, les points saillants ci-après. Du côté rwandais, leur demande principale porte sur la neutralisation des forces démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR) qui seraient encore actif sur le territoire congolais. A ce sujet, le Rwanda clame tout haut que l’application de l’accord de paix dépend de cette condition et certains observateurs congolais s’accrochent également à ce niveau pour prétendre que le Congo serait roulé dans la farine parce qu’il s’agirait à travers cette conditionnalité, d’un prétexte justifiant la poursuite de l’occupation rwandaise d’une partie de notre pays. D’autre part, du côté congolais, les acquis essentiels couvrent le désengagement des forces rwandaises sur le sol congolais, l’affirmation de la souveraineté de la RDC, ainsi que le respect de l’intégrité du territoire national. De même, en commun, les deux parties conviennent de la prohibition de tout soutien à des groupes armés.
A cet égard, nous devrions reconnaitre que la signature de cet accord est véritablement un succès et un pas en avant vers le retour de la paix en RDC, tel que souhaité par l’ensemble de notre peuple. Ainsi donc, les critiques positives ne sont pas mauvaises dans une aire de démocratie. Mais la reconnaissance de la bravoure et du patriotisme de certains d’entre nous devrait être mis en exergue. Aussi l’occasion est indiquée pour féliciter la ministre congolaise des affaires étrangères Thérèse KAYIKWAMBA WAGNER, ainsi que le Président de la République, Son Excellence Felix Antoine Tshisekedi pour sa forte détermination à ramener la paix et à convaincre la communauté internationale sur le plan diplomatique.
En ce qui concerne la réussite proprement-dit des accords.Nous devrions avoir en mémoire et pour convaincre les esprits dubitatifs que le droit international est un droit imparfait contrairement au droit interne. Et les accords signés au niveau international, ne devrait pas être considéré comme une sinécure.
Par sa nature, tout accord qui doit s’imposer à tous devrait bénéficier des mesures d’accompagnement au niveau juridique, politique, et même institutionnel. Dans le cas l’accord Congolo – rwandais signé à Washington le 27 juin 2025, il faut d’abord tenir compte des mécanismes qui existent et qui consolident le respect de l’accord par les deux parties.En premier lieu, il s’agit de la résolution 2773 du conseil de sécurité (21 février 2025) qui impose des obligations aux parties.
En effet, cette résolution demande en particulier « à la Force de défense rwandaise de cesser de soutenir le M23 et de se retirer immédiatement du territoire de la République démocratique du Congo, sans conditions préalables ».
Il est donc faux de croire que l’accord aurait bradé la valeur de cette résolution compte tenu de la hiérarchie des instruments juridiques sur le plan international.Il ne faut surtout pas oublier que du point de vue de la charte des nations unies, particulièrement à ses articles 39 à 42, la responsabilité de la paix, et surtout lorsqu’il y a rupture de celle-ci, incombe au conseil de sécurité des nations unies.
Ainsi donc, les congolais devraient enlever toute inquiétude par rapport à l’application de l’accord.Le second mécanisme favorisant la consolidation de l’accord dans le cas d’espèce, constitue le parrainage des Etats unies d’Amérique. En effet, même s’ils ne sont pas signataire de l’accord, les USA apporte bel et bien leur caution morale et politique pour la réussite de toutes les négociations entre la RDC et le Rwanda. Nous devrions rappeler à l’opinion que dans l’histoire, les Etats unis d’Amérique étaient la première puissance au monde à reconnaitre l’Etat indépendant du Congo (EIC) le 22 avril 1884, à obliger le Roi Leopold II à céder l’EIC à la Belgique en 1908, et lorsqu’il fallait appuyer l’indépendance du Congo vis-à-vis de la Belgique en 1959/1960, les Etats-Unis ont joué un rôle important.
Au-delà de ces mécanismes internationaux, l’accord entre le Congo et le Rwanda, comme du reste n’importe quel autre accord, doit être accompagné et consolidé par des dispositions internes à notre pays. Il s’agit premièrement pour les dirigeants de notre pays, de réorganiser l’armée congolaise, de former ses hommes, de les équiper et de les motiver. Il faut surtout souligner à l’attention de nous tous que le monde moderne depuis un certain nombre d’année, tout en se référant aux dispositions juridiques formulées par les Etats à travers particulièrement le pacte de la Société des Nations (SDN) et par la suite la charte des nations unies, fonctionne sur base du principe des rapports de forces. Il faudrait pour cela examiner ce qui passe entre la Russie et l’Ukraine, Entre Israel et la Palestine, et tout dernièrement, la courte crise entre l’Iran et Israel.
En outre, il y a lieu de penser à reformer notre administration publique, en y dénichant de manière approprié tous les suspects qui y sont infiltrés et de faire de cet outil le socle de la bonne gouvernance en RDC. Nous devons reconnaitre, que le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi a depuis qu’il a accédé au pouvoir en 2019, jeté les vrais jalons pour la reconstruction de la République démocratique du Congo en vue de la défense de la Patrie et l’amélioration de la qualité de vie de tous les Congolais. C’est pourquoi, il mérite l’encouragement de tous au lieu des critiques souvent sans fondement.
Main dans la main, tous les congolais derrière le commandant en Chef, nous allons sécuriser notre beau pays et le conduire vers son émergence.





